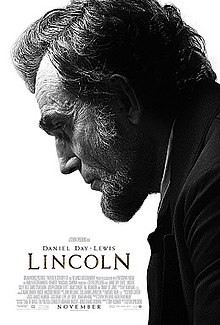Deux visions littéraires de la mort d'écrivains extraits de "Choses vues" pour Victor Hugo et du journal d'Albin de Saint-Aubain, époux de la poétesse parnassienne, pour Aurore-Marie de Saint-Aubain.
La mort de Balzac par Victor Hugo :
"Le 18 août 1850, ma femme, qui avait été dans la journée pour voir Mme de
Balzac, me dit que M. de Balzac se mourait. J'y courus.
M. de Balzac était atteint depuis dix-huit mois d'une hypertrophie du cœur.
Après la révolution de Février, il était allé en Russie et s'y était marié.
Quelques jours avant son départ, je l'avais rencontré sur le boulevard ; il se
plaignait déjà et respirait bruyamment. En mai 1850, il était revenu en France,
marié, riche et mourant. En arrivant, il avait déjà les jambes enflées. Quatre
médecins consultés l'auscultèrent. L'un d'eux, M. Louis, me dit le 6 juillet :
Il n'a pas six semaines à vivre. C'était la même maladie que Frédéric Soulié.
Le 18 août, j'avais mon oncle, le général Louis Hugo, à dîner. Sitôt levé de
table, je le quittai et je pris un fiacre qui me mena avenue Fortunée, n° 14,
dans le quartier Beaujon. C'était là que demeurait M. de Balzac. Il avait
acheté ce qui restait de l'hôtel de M. de Beaujon, quelques corps de logis bas
échappés par hasard à la démolition ; il avait magnifiquement meublé ces
masures et s'en était fait un charmant petit hôtel, ayant porte cochère sur
l'avenue Fortunée et pour tout jardin une cour longue et étroite où les pavés
étaient coupés çà et là de plates-bandes.
Je sonnai. Il faisait un clair de lune voilé de nuages. La rue était déserte.
On ne vint pas. Je sonnai une seconde fois. La porte s'ouvrit. Une servante
m'apparut avec une chandelle. « Que veut monsieur ? » dit-elle. Elle pleurait.
Je dis mon nom. On me fit entrer dans le salon qui était au rez-de- chaussée,
et dans lequel il y avait, sur une console opposée à la cheminée, le buste
colossal en marbre de Balzac par David. Une bougie brûlait sur une riche table
ovale posée au milieu du salon et qui avait en guise de pieds six statuettes
dorées du plus beau goût.
Une autre femme vint qui pleurait aussi et me dit :
« Il se meurt. Madame est rentrée chez elle. Les médecins l'ont abandonné
depuis hier. Il a une plaie à la jambe gauche. La gangrène y est. Les médecins
ne savent ce qu'ils font. Ils disaient que l'hydropisie de monsieur était une
hydropisie couenneuse, une infiltration, c'est leur mot, que la peau et la
chair étaient comme du lard et qu'il était impossible de lui faire la ponction.
Eh bien, le mois dernier, en se couchant, Monsieur s'est heurté à un meuble
historié, la peau s'est déchirée, et toute l'eau qu'il avait dans le corps a
coulé. Les médecins ont dit : Tiens ! Cela les a étonnés et depuis ce temps-là
ils lui ont fait la ponction. Ils ont dit : Imitons la nature. Mais il est venu
un abcès à la jambe. C'est M. Roux qui l'a opéré. Hier on a levé l'appareil. La
plaie, au lieu d'avoir suppuré, était rouge, sèche et brûlante. Alors ils ont
dit : Il est perdu ! et ne sont plus revenus. On est allé chez quatre ou cinq,
inutilement. Tous ont répondu : Il n'y a rien à faire. La nuit a été mauvaise.
Ce matin, à neuf heures, monsieur ne parlait plus. Madame a fait chercher un
prêtre. Le prêtre est venu et a donné à Monsieur l'extrême- onction. Monsieur a
fait signe qu'il comprenait. Une heure après, il a serré la main à sa soeur,
Mme de Surville. Depuis onze heures il râle et ne voit plus rien. Il ne passera
pas la nuit. Si vous voulez, monsieur, je vais aller chercher M. de Surville,
qui n'est pas encore couché. »
La femme me quitta. J'attendis quelques instants. La bougie éclairait à peine
le splendide ameublement du salon et de magnifiques peintures de Porbus et de
Holbein suspendues aux murs. Le buste de marbre se dressait vaguement dans cette
ombre comme le spectre de l'homme qui allait mourir. Une odeur de cadavre
emplissait la maison.
M. de Surville entra et me confirma tout ce que m'avait dit la servante. Je
demandai à voir M. de Balzac.
Nous traversâmes un corridor, nous montâmes un escalier couvert d'un tapis
rouge et encombré d'objets d'art, vases, statues, tableaux, crédences portant
des émaux, puis un autre corridor, et j'aperçus une porte ouverte. J'entendis
un râlement haut et sinistre. J'étais dans la chambre de Balzac.
Un lit était au milieu de cette chambre. Un lit d'acajou ayant au pied et à la
tête des traverses et des courroies qui indiquaient un appareil de suspension
destiné à mouvoir le malade. M. de Balzac était dans ce lit, la tête appuyée
sur un monceau d'oreillers auxquels on avait ajouté des coussins de damas rouge
empruntés au canapé de la chambre. Il avait la face violette, presque noire,
inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts,
l'oeil ouvert et fixe. Je le voyais de profil, et il ressemblait ainsi à
l'Empereur.
Une vieille femme, la garde, et un domestique se tenaient debout des deux côtés
du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une
commode près de la porte. Un vase d'argent était posé sur la table de nuit. Cet
homme et cette femme se taisaient avec une sorte de terreur et écoutaient le
mourant râler avec bruit.
La bougie au chevet éclairait vivement un portrait d'homme jeune, rose et
souriant, suspendu près de la cheminée.
Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et je pris
la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit
pas à la pression.
C'était cette même chambre où je l'étais venu voir un mois auparavant. Il était
gai, plein d'espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en
riant. Nous avions beaucoup causé et disputé politique. Il me reprochait « ma
démagogie ». Lui était légitimiste. Il me disait : « Comment avez-vous pu
renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après
le titre de roi de France ! » -- Il me disait aussi : « J'ai la maison de M. de
Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église du coin de
la rue. J'ai là dans mon escalier une porte qui ouvre sur l'église. Un tour de
clef et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu'au jardin. » --
Quand je l'avais quitté, il m'avait reconduit jusqu'à cet escalier, marchant
péniblement, et m'avait montré cette porte, et il avait crié à sa femme : «
Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. »
La garde me dit : « Il mourra au point du jour. »
Je redescendis, emportant dans ma pensée cette figure livide ; en traversant le
salon, je retrouvai le buste immobile, impassible, altier et rayonnant
vaguement, et je comparai la mort à l'immortalité.
Rentré chez moi, c'était un dimanche, je trouvai plusieurs personnes qui
m'attendaient, entre autres Riza-Bey, le chargé d'affaires de Turquie,
Navarrete, le poète espagnol et le comte Arrivabene, proscrit italien. Je leur
dis : « Messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. »
Il mourut dans la nuit. Il avait cinquante et un ans. "
Extrait du journal d'Albin de Saint-Aubain (1858-1918) année 1894 :
28 janvier 1894.
La comédie avait suffisamment duré.
Nous ne pouvions plus la prolonger outre mesure. Ma pauvre Aurore-Marie se
mourait presque. Cela, elle le savait. J’écrivis à Madame de Tournel afin de
lui signifier que nous en resterions là. Je lui demandai qu’on louât une
voiture pour Rochetaillée, ce domaine étant à même de permettre à mon pauvre
petit ouistiti d’achever dans l’apaisement et la quiétude son douloureux
parcours ici-bas.
Un sentiment de culpabilité m’étreint
à la rédaction de ces lignes. Pourquoi, malgré l’implacable diagnostic du
docteur de Lapparent, ai-je une fois de trop cédé à ton caprice? Lorsqu'il t’examina
voici un mois, sa conclusion fut pourtant sans appel : ma bien aimée, non
seulement la phtisie rongeait tes poumons, mais le rein gauche et l’estomac étaient
aussi atteints! De plus, Maubert de Lapparent, comme auparavant une des sœurs
de l’Institution Notre-Dame, décela une grosseur suspecte au niveau abdominal.
Je me suis rappelé ce que tu me contas sur ta mère, ma chérie... Il ne faisait
plus de doute que le même mal te détruisait, ce pernicieux kyste ovarien qui,
faute d’avoir été extrait à temps par le biais du bistouri, dégénérait désormais
en squirre. Tu t’étais toujours plainte de douleurs lorsque s’imposait à toi le
devoir conjugal. Cela expliquait pourquoi, à l' exception de notre pauvre Lise,
tu n’avais pu tenir aucune gestation jusqu' à son terme. Depuis bientôt cinq
années, sur les injonctions impératives de Maubert, nous dûmes faire chambre à
part. Dans ce cas, je n' ai pas compris ta dernière fausse couche de novembre,
en pleine Institution, sous la défroque de notre fille regrettée, accident fâcheux
qui t'a sans doute achevée et a précipité, hâté ta consomption, ô, ma chérie!
Je pressens quelque infidélité pour laquelle tu devras rendre des comptes
lorsque Dieu t’appellera à Lui. Mais j’ai beau conjecturer, je ne vois pas « qui »...
De même, j’ai compris la raison
irrépressible qui te poussa à passer ces trois semaines de trop à Notre-Dame de
La Visitation. L’objet en était une de tes passions déviantes, une de plus, tel
celui de cette funeste confession criminelle d’il y a tantôt deux années,
confession scandaleuse sur laquelle je me refuse à en dévoiler davantage, au
cas où ce carnet viendrait à tomber en des mains indiscrètes... Je sais qu’elle
se nomme Delphine et qu’elle a de merveilleux cheveux de jais... mais elle a à
peine douze ans! Je l’ai vue à ce fameux concert de chambre, chez Madame De
..., lorsque tu défaillis en public. Je préfère évoquer nos anciens
souvenirs... T’en souvient-il, comme l’écrivit le poëte?... Mon Aurore aux
doigts de rose, ma Marie pleine de grâce? C’était en juillet 1880... Tu avais
alors dix-sept ans et déjà le génie de l’écriture, de la versification, la foi
en ton destin d’exception chevillée au corps. Ce déjeuner sur l’herbe que nous
fîmes auprès des rives de la Saône, fraîchement mariés. Cette robe blanche sans
tache, ce petit chapeau de paille d’Italie sur ton minois elfique à la diaphanéité
proverbiale, cette ombrelle... et ce poulet froid que nous convoitaient les
fourmis! Mon Aurore, ma gracieuse aux yeux de colophane, aux cheveux de miel
cendré, de cette extraordinaire longueur que nombre de jeunes filles te
jalousaient... tout cela s’estompe, ombre qui ne sera plus... fonte des neiges
pleurée par le Sage chinois...
(...)
22 février.
Nouveaux répits, nouvelles
rechutes, allers retours incessants du lit à la chaise, et de la chaise au lit.
Comme ta mère, je t’humecte d’eau de Cologne, d’huile mentholée, pour masquer
ces relents qui t’envahissent peu à peu. A la tuberculose se rajoute la tumeur
en ton organe intime. Je ne veux pas ta mort, mon aimée! Jamais le Vieillard
Temps n’osera! Tu es trop jeune! Même pas trente et un ans!
23 février.
Un médecin a inventé un nouveau
procédé permettant aux asthmatiques, à ceux que gagne l’étouffement morbide, de
pouvoir respirer. Il s’agit du stockage de l’oxygène dans des sortes de
ballons. Non pas comme l’hydrogène de nos aérostats, mais le principe est
cependant le même. Tout doit être tenté pour te sauver, mon adorée, mon
ouistiti charmant, tant qu’il reste un espoir... Tu es transparente, évanescente,
ô mon elfe!... La peau se tend sur tes joues décharnées, si pâles, si pâles...
Essaie, essaie encore de boire pour moi ce bouillon de poule... Là, voilà qui
est bien... Vis, mon gentil aubépin, vis sans fin, ma rose...
25 février.
Je tentais de contacter Maubert
de Lapparent au sujet de ces « ballons » d’oxygène, lui enjoignant
par télégramme - Rochetaillée n’a pas le téléphone, contrairement à notre hôtel
particulier de l’avenue des Ponts - de venir en urgence, pour un nouvel examen.
Savoir si la stabilité apparente de ton mal allait se prolonger ou si ce répit
de plus n’était qu’un dernier sursaut inutile... Connaître le remède miracle,
te l’appliquer, ma mie, ma poëtesse adorable, mon rêve blond de miel... Es-tu
encore curable?
26 février.
Maubert est venu, en fin d’après-midi,
par un fort mauvais temps. Tu avais à peine mangé ce matin. Il t’a vue sur la
chaise, tâté ton pouls... Il a respiré l’odeur morbide qui parvenait à percer
celle du camphre, des substances mentholées, médicamenteuses... une odeur, une
fragrance mêlant subtilement la créosote, agent préservateur du bois et ce que
l’on peut qualifier de déjà putride... Tu souffres d’affreux ballonnements et
tu ne puis plus rien absorber de solide, ma pauvre petite poupée... Maubert a déclaré
: « Elle commence à souffrir d’arythmie respiratoire et cardiaque. Mais sa
résistance m’étonne. Madame s’accroche... Cependant, si elle ne meurt pas du
poumon, le squirre ovarien galope et se ramifie... Enveloppez-la de serviettes
chauffées... Si une congestion pulmonaire se déclare, elle subira une hémoptysie
ultime et succombera. Pas d’entrée d’air frais, quelle que soit l’odeur
insupportable... » Aurore-Marie entendit et murmura : « Un prêtre...
Delphine... Je souhaiterais un prêtre à mon chevet... Que Delphine vienne
aussi, mon Dieu! »
27 février.
Le matin, après une mauvaise nuit
passée auprès de l’aimée qui s’est refusée à quitter la chaise longue,
Aurore-Marie a balbutié :
« De l’air... Albin, ouvre!
Ouvre la fenêtre! ... Je suffoque, j’étouffe! Je... je renie Cléophradès, Kulm,
les Tétra-épiphanes et tout ce saint-frusquin... je renonce à ma charge...
prends ma chevalière Albin. Prends-la... Ramène-la à Kulm, ce pauvre dépravé! »
Elle a ôté le bijou qu’elle m’a
tendu de ses doigts translucides, puis elle m’a supplié d’ouvrir la fenêtre
encore une fois, alors qu’il gelait à pierre fendre et que les frimas d’un
tardif coup de froid faisaient ressentir leurs cruelles morsures. Tu as également
mendié la permission de jouer une dernière fois au clavier cet air obsessionnel
et romantique, hymne de ta Lisa-Deanna, ou de ce Stefan Brand ou je ne sais
trop qui que tu m’as dit avoir connus voici près de six ans... En cas de
rechute grave, de congestion, je devais rappeler Maubert qui nous enverrait une
infirmière à ton secours... avec les « ballons ». Une fois de plus,
de trop, tu as été trop faible pour que je pusse te monter dans la chambre et
tu as passé la nuit sur la chaise longue, à te morfondre, à somnoler, ou à
geindre... lorsque tu ne crachais pas! Mal m’en a pris.
28 février.
Nous te retrouvâmes, les
domestiques et moi, à terre, renversée de la chaise, ayant craché du sang, la
porte-fenêtre grande ouverte sur la véranda, sur le froid glacial qui
envahissait le salon... Tu avais désobéi, comme si souvent chez toi, ou plutôt,
cédé à tes pulsions... La congestion fatale s’était déclarée. Par miracle, tu
respirais encore, ô, mon aimée, mon Aurore-Marie! Ce n’était qu’une de ces
syncopes dont tu es las coutumière! Nous dûmes improviser une civière, te
transporter là-haut, en ta chambre de mort, que tu n’allais plus quitter... Il
fallut te déshabiller, te changer, te mettre une chaude chemise de nuit doublée
de lainage... Des taches de sang, des plaies, se révélèrent en ton dos... les
escarres... Tu revins à toi, toussant, haletant... Tu délirais, la face
luisante, récitant des vers d’une naïveté de comptine, de nursery-rhyme... un
de tes premiers poëmes écrit alors que tu n’avais que dix ans...
« Dans la forêt, à l’ombre des bosquets
Il était une cabane où vivait un père récollet.
Il était une cabane à l’ombre des bosquets.
Au bois, le cerf en sa ramure
Dit bonjour au renard, lui proposant des mûres.
Dis bonjours au renard, ô, cerf en ta ramure! »
Était-ce là, ma future
parnassienne hermétique? Ces vers, ô, ces vers spontanés, si naïfs, si frais,
que tu avais reniés, ma mie, mon ouistiti, et qui revenaient à ta remembrance, à
l’article de la mort!
« Au bois joli, les
oiseaux chantent,
Chantent en la forêt le retour
de l’été,
Chantent au bois joli les
passereaux coquets.
Le sanglier gentil, le daim
mignon,
Saluent monsieur le chêne
A l’ombre des troènes,
Saluent monsieur le chêne et le
beau champignon! »
Et tu chantonnais ces vers
mignards de ta petite voix de cristal... ces vers que je me surpris à répéter,
entrant dans ton jeu. Était-ce toi qui avais écrit cela en ton enfance?
Pourquoi n’avais-tu pas persévéré dans ton premier style? Pourquoi? Quel
traumatisme assez puissant t’avait donc poussée à la complexité, à cette manière
abhorrée des Catulle Mendès et des Leconte de Lisle? Tu balbutias : « Mon
frère, ma mère, ô pauvre maman... leur mort... le chagrin... je... je me réfugiai
dans les « Poëmes antiques » de Leconte de Lisle et je découvris ma
vraie voie... la Seule Voie... » J’ordonnai que l’on télégraphiât à
Maubert afin qu’il nous envoie l’infirmière. Tu hoquetas en disant : « Le
prêtre... convoque le prêtre... Il est temps mon Albin. »
Il y eut un nouvel étouffement, où
je crus que tu allais passer. Alphonsine m’aida à te soulager par une piqûre d’huile
camphrée... Tu étais si congestionnée, si rouge... Mais tu fus promptement
apaisée et tu te rendormis, non d’un sommeil normal, mais dans un de ces états
que la médecine qualifie de semi comateux, entre deux mondes, deux limbes,
entrecoupé de réveils où tu geins, où tu te plains, où tu halètes, où tu bégaies
: « Mal... mal... je... j’ai grand mal... »
1er mars.
J’ai passé une nuit épouvantable,
veillant incessamment mon aimée, attendant l’infirmière... Je me suis décidé à
appeler le prêtre ce matin. Mon Aurore, comme tu souffres! Délivre-la, Seigneur
de la fureur de son mal! Elle a murmuré : « Albin... m’aimes-tu toujours,
même dans cet état? Je suis tellement affreuse! » Puis, elle a toussé et
craché... Les expectorations la souillent...
9 heures.
L’infirmière est arrivée : c’est
une femme hommasse, sans âge, bâtie comme un percheron, qui a l’habitude de
soulever, de manipuler les corps des malades. Elle m’a dit : « Allez
dormir, monsieur. Je prends le relais... » Elle a expliqué qu’elle
renouvellerait les badigeons d’eau de Cologne afin de masquer les mauvaises
odeurs. Elle a apporté les ballons d’oxygène. Elle a recommencé les injections
de gaïacol avec la seringue de Pravaz. Cette nuit, ma pauvre femme-enfant s’était
souillée comme un petit bébé. Il a fallu nettoyer cette horreur. De même, ses
escarres puaient... « Nous allons la panser, renouveler régulièrement les
pansements... La gangrène risque de s’y mettre. » Me déclara Madame
Langlois, l’infirmière. Aurore-Marie ne se laissa pas facilement faire : elle
gigota et cria. Lorsqu'elle fut calmée, sa respiration, quoique régulière et
non empreinte de secousses quinteuses, m’apparut plus sifflante qu’à l’ordinaire...
« Il y a de nouvelles cavernes et un début de pleurésie », m’expliqua
Madame Langlois.
14 heures.
Aurore-Marie est sortie de son hébétude
et à réclamé à boire et à manger. Madame Langlois lui a fait absorber un
bouillon. Elle a constaté que mon aimée avait perdu deux dents.
18 heures.
Arrivée du prêtre. J’étais
parvenu à me reposer, à sommeiller deux heures dans l’ottomane où mon pauvre
ouistiti aimait tant à goûter à une langoureuse et dolente quiétude. Je
songeais qu’il me fallait montrer mon affection pour ma rose, tenir sa petite
main si ténue, caresser ses beaux cheveux, ses joues maigres, partager ses
pleurs et ses douleurs. Aurore-Marie a refusé l’extrême-onction.
« Trop tôt... Je vis encore...
je souhaite me confesser... plutôt retourner dans le giron de l’Église de mes pères,
que d’ignobles sectateurs m’obligèrent à renier à l’âge de quatorze ans... J’ai
péché mon père ; j’ai dû apostasier! Je veux échapper à la damnation éternelle!
Je ne veux plus être une hérétique... j’ai restitué mon anneau horrible...
» (je venais d’envoyer l’anneau dit « du Pouvoir » au baron
Kulm, à Paris)
Le père Mathieu m’intima l’ordre
de sortir de la chambre, au nom du secret de la confession. Ma pauvre petite femme!
Qu’as-tu donc accepté de révéler au ministre de Dieu que je ne susse déjà, tous
ces secrets intimes, hideux, que nous nous refusassions à jeter en pâture à la
vindicte publique, et qui avaient entraîné l’exécution d’un innocent, ce
malheureux Hubeau? A moins que tu lui aies confessé le secret de ta fausse
couche, la mort cachée de Lise, tes penchants troubles pour Delphine, que je
commençais, malgré moi, à brûler de revoir... A moins qu’il se fût encore agi
de ton lubrique ouvrage, cet obscène « Trottin », avec l'étalage
complaisant du stupre, de la pire déviance de Gomorrhe, personnifiée par cette
odieuse héroïne sortie de ton imagination de folle : Cléore de Cresseville? Et
tes frasques parisiennes d'il y a six années, lorsque tu daignas devenir plus
loquace... cette Deanna Shirley, petite blonde dépravée s'il en fût, amatrice
des beuglants, des boxons, de tout un bataclan de lubricité, sous la défroque dérisoire
et infantile d'un « bébé anglais », modèle de ta Cléore! Cette même
Deanna Shirley que tu aimas d'un amour saphique quasi exclusif, pire que ceux
que tu avais éprouvés pour Marguerite, pour Delphine, pour Angélique de
Belleroche et tant d'autres, fille de joie que tu m'avouas avoir rencontrée
enfin pour de vrai, à laquelle tu tentas de te substituer, cette prétendue « jumelle »
dont tu t'étais amourachée...
2 mars.
Le père Mathieu a accepté de
passer la nuit dans une chambre d’hôte, sans toutefois piper mot. Il promit de
revenir afin d’assurer la conversion de la nouvelle fidèle, ou plutôt, de la
brebis égarée revenue au bercail du Bon Pasteur... Puis, lorsque Madame aurait
enfin été lavée de tous ses péchés, aussi nombreux qu’ils fussent, l’extrême-onction
lui serait administrée... Il fallait faire vite ; ma tendre moitié, mon adorée
pouvait passer d’un seul coup, comme tous les tuberculeux, par une simple hémoptysie
de trop, sans agonie proprement dite, sans râle aucun...
Le prêtre parti, Madame Langlois
reprit son service. Elle surprit Aurore-Marie en plein délire mystique, un
missel ouvert posé sur la couverture, sur sa poitrine maigre, le roman « Le
Disciple » de monsieur Paul Bourget, cette bien connue histoire de
conversion, gisant sur la table de chevet... Par-dessus tout, elle serrait
contre elle un crucifix qu’elle embrassait avec frénésie, en une extase
trouble, quasi -j' ose à peine l’écrire- érotique, en cela que ses baisers
avaient pour objet le corps souffrant et dénudé de Notre Seigneur. Elle ne
cessait de balbutier : « Mon Dieu, prends pitié, ô Christ, prends pitié!
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié! »
C’était un horrible spectacle,
dans cette chambre confinée qui sentait le médicament et les effluves
infectieux, les atteintes gangrenées de ses escarres qui se multipliaient...
Aurore-Marie imprégna le crucifix d’une bave hideuse, de ses expectorations
sanguinolentes... Elle porta à ma souvenance une agonie littéraire, celle bien
connue de la scandaleuse Emma Bovary... Madame Langlois me rudoya : elle devait
s’activer à prodiguer ses soins : déshabillage, désinfection des escarres,
serviettes et compresses chaudes, badigeons d’eau de Cologne, injections de gaïacol
et d’huile camphrée...
(...)
9 mars.
La mort de mon aimée n'est plus
qu'une question d'heures. Le prêtre ne la quitte plus. Il récite sans cesse les
prières aux agonisants et ma pauvre petite chérie l'accompagne, poupée diaphane
et minuscule aux miasmes morbides, aux longs cheveux épars, à laquelle nous ne
parvenons plus à administrer la moindre injection, le moindre ballon d'oxygène.
J'ai envoyé Huberte au bureau des télégraphes prévenir la famille de
mademoiselle Ibañez y León, la fameuse Delphine que ma mie ne cesse de réclamer
entre deux étouffements. Pensant son devoir accompli, le prêtre a sollicité son
congé, une fois de plus.
« Votre épouse peut mourir
en paix. » s'est-il contenté de me déclarer.
Aurore-Marie sombre dans une
demi-inconscience, où elle demeure, comme prostrée, absente, parfois jusqu'à
une à deux heures d’affilée, dont elle n'émerge que par intermittences pour gémir
et suffoquer. Elle geint, se plaint de brûlures, pis que celles d'un fer rouge,
de douloureux et lancinants élancements au niveau des ovaires. Ses
expectorations se font plus espacées. Mais elle est prise de palpitations cardiaques,
qui m'inquiètent au plus haut point : ce pouls irrégulier, chaotique, imprévisible,
que dis-je, imprédictible, n'est-il pas
le signe avant-coureur de la fin? Je ne dormirai pas cette nuit.

10 mars.
Maubert est arrivé à minuit
trente en pensant que le trépas d'Aurore-Marie était imminent. Il a fallu lui
administrer quatre ballons d'oxygène. Comment l'aimée est-elle parvenue à
absorber ce brusque afflux gazeux? Elle en parut conséquemment ivre, avant de
se calmer une nouvelle fois.
Puis, elle a dormi jusqu'à neuf
heures. Épuisé, je sommeillais moi-même à son chevet. Lorsqu'elle s'est réveillée,
elle a balbutié d'une voix faible, plus familière :
« Le prêtre...qu'il
revienne...je peux trépasser aujourd'hui, je le sens... Et Deanna, où est-elle?
Delphine viendra-t-elle? Je vivrai jusqu'à ce que tu sois là, ma
Delphine... »
A midi, Norbert m'a rapporté un
pneumatique : mademoiselle Ibañez y León, du fait de ses obligations scolaires
et familiales, ne serait là que le lendemain matin. Aurore-Marie, je t'en
supplie! Tiens, tiens encore! Un jour, ne serait-ce qu'un jour!
Mon adorée a recommencé à délirer,
à déblatérer, débagouler, comme on disait en l'ancien temps. Elle parlait de
Deanna...de ce qui s'était passé avec elle en 1888 à Paris, puis à Venise avec
un certain Tellier que je ne connaissais nullement, n'ayant jamais ouï ce nom
avant cette sombre journée... Mon aimée s'accusa d'un nouveau meurtre, d'un
assassinat vénitien... De même, elle regretta d'avoir occis en duel, au
pistolet, la publiciste Yolande de La Hire... Toutes ses turpitudes
continuaient de la hanter...
Comment une poitrinaire au
dernier degré de la consomption parvenait-elle à parler aussi longtemps sans
succomber? Quelle énergie t’habitait-elle encore, mon petit ouistiti adoré? Ta capacité
de résistance m'étonnera toujours dans cet organisme, ce corps si fluet.
L'espoir fait vivre et tu vivras en moi pour les siècles des siècles, comme la
poignante et pathétique Lison de ton poëme, « Si belle dans ta richesse
blanche ».
A quinze heures, nouveau
pneumatique, qui m'intrigua et m’ébaudit :
« Arriverai demain à
quatorze heures. Signé Deanna Shirley de Bièvres de Beauregard. »
Je lus le pneumatique à
Aurore-Marie qui en pleura de joie...cette nouvelle la réconforta au plus haut
point et la prolongea encore, encore... Je murmurai la fin de ton fameux vers :
« (...) N’attends pas le
tombeau. »
Je verrai enfin Deanna le
lendemain après midi... Savoir si elle te ressemble autant que ce que tu m'en
as conté.
A dix-sept heures, le père Mathieu
est revenu.
« Aurore-Marie est encore
parmi nous... lui dis-je. Entendez-la chantonner, babiller, les poëmes qu'elle
composa lorsqu'elle était fillette. »
Un gazouillement traversait la
porte de la chambre :
« L'oiseau réclame sa
pitance,
Le passereau joli, ô ma joie,
mon enfance! (bis)
Le passereau mignon à mon bon
souvenir
Bat des ailes pour saluer le
beau temps à venir... »
C'était comme si elle eût été
atteinte d'une régression infantile, de ce que les Italiens appellent « rimbambita ».
« Chante, chante oiseau
merveilleux!
Chante à jamais, au ciel bleu
lumineux! »
Je fondis en larmes à l'écoute de
ces vers si bucoliques et si agrestes. Pourquoi, mon ouistiti, pourquoi as-tu
abandonné ton premier style? Oui, pourquoi? Pourquoi ces affreux okéanides, ces
références mythologiques? Je te maudis, Parnasse!
« Rose! Rose de pourpre,
fraise des bois!
Saluez Dame Nature et la bonne
confiture!
La confiture que mère-grand
autrefois prépara
Pour la splendide enfant qui
au bois s'égara! »
Cette prosodie oubliée, ces poëmes
reniés, revenus du néant, de l'au-delà de son songe... Résurrection!
« Monsieur du Soleil et
Dame la Lune
Sentez donc le printemps
embaumant et le joli été
Où s'affaire l'abeille lorsque
tombe la brune,
Le cornouiller joli, la giroflée
amie, ô ma beauté!
Le cerf de Saint-Hubert
sortant de la ramée!
Ô saison des amours en la
belle ramure
Profite de ces jours, ma fille
bien nommée
Écoute encor le brame, ô ma
mie, ma très pure! »
Mais la toux te reprit. La
rechute, la rechute, hélas! Crainte, redoutée et fatale... j'entrai tout de même
dans la chambre, désirant jusqu'à l'ultime instant tenir ta petite main, ma
pauvre petite poupée... Je compris qu'on oublierait ton nom, postérité cruelle,
du fait du reniement de ton style originel. Simple! Il eût fallu que tu
composasses, que tu écrivisses des vers simples! Il fallait rester simple,
frais, spontané. Tu aurais été alors l'égale de Marceline Desbordes-Valmore! Il
n'en sera hélas rien.
Aube du 11 mars 1894.
Je ne sais comment nous pûmes
dormir. Je m'éveillai vers les six heures, me surprenant à caresser ta jolie
petite main érubescente. Tu n'étais déjà plus qu'une ombre évanescente mais tu
vivais encore. Le prêtre, à genoux, psalmodiait ses prières. J'eus la vision
suprême de ce lit bientôt vide. Cette prescience m'ôta tout espoir illusoire.
Je me souvins d'un vers de Dante Alighieri, dont la « Divine comédie »
avait inspiré Franz Liszt :
« Voi chi entrate,
lasciate ogni speranza! »
Il s'agissait de l'inscription
qui, tel un frontispice, marquait le linteau de la porte des Enfers. Une pensée en entraînant une autre, mon
cerveau en vint à évoquer l'épigraphie latine, particulièrement celle à caractère
funéraire, que l'on retrouvait sur maintes stèles de la Rome républicaine ou
impériale, science qu'illustraient les études de ce célèbre historien allemand,
monsieur Mommsen. Inévitablement, ce fut un autre des poëmes de l'aimée qui
s'imposa à mon esprit : les « Fragments d'un grammatiste antique » et
ce vers en particulier :
« Cippe, tertre, mausolée,
cénotaphe, chef-d'œuvre de l'épigraphe ».
Certaines éditions, particulièrement
celles circulant dans les pays anglo-saxons, s'avéraient fautives, en cela
qu'elles rajoutaient la stèle, intercalée entre le tertre et le
mausolée. Cela donnait conséquemment le résultat suivant :
« Cippe, tertre, stèle,
mausolée, cénotaphe, chef-d'œuvre de l'épigraphe... »
Qu'importaient désormais à mon cœur
ces miasmes de mort, ton haleine fétide, ces escarres où la gangrène se
mettait, les spasmes de ta respiration, les filets de sang s'épanchant de-ci,
de-là, qui sortaient soit de ton nez, soit de ta bouche pâle. J'entendis un ora
pro nobis. Tu t'éveillas, du moins, je le pensai, car, chez toi, le
sommeil ne voulait plus rien dire. Tes cheveux, tes beaux cheveux magdaléniens
de blondine, de sylphide luminifère, ton regard d'ambre, la triangularité de
ton ovale que je n'oublierai jamais, ma mie, ma petite poupée, mon ouistiti chéri...
à jamais....
Tu marmottas : « La
pendule... Je ne veux plus la voir... Elle m'annonce la mort... Mon temps
terrestre s'achève... »
Et le père de répliquer :
« Le Ciel, songez au Ciel...
- J'ai peur des enfers, des
enfers antiques aux âmes errantes... Les lémures, les morts d'Ulysse et d'Orphée...
Non! Pas Cerbère! Pas l’Amenti! »
Tu étouffas et haletas, ta
poitrine atteinte de secousses spasmodiques. Je ne songeais même plus aux
ballons d'oxygène, qu'il eût fallu d'une plus grande capacité. Toutefois,
Madame Langlois entra faire son office, te changer, te nettoyer, te piquer. Je
t'entendis gémir!
« Oh! Oh! Pitié! Non!
Non! »
Tu souffrais trop car je savais
que le squirre avait atteint, comme pour ta maman adorée, la membrane utérine.
De quelle hémorragie seras-tu atteinte à la fin? Qu'est-ce qui cèdera en
premier? Le ventre ou les poumons? Messieurs les Diafoirus, les Purgon, je vous
hais tous et vous maudis pour l'éternité! J'abhorre la Faculté!
Il était huit heures : Madame
Langlois m'a prié d'aller me reposer ailleurs, de faire un brin de toilette, de
me raser. Elle demanda au prêtre de faire de même, de sortir de la chambre, car
elle devait tenter de laver la patiente. Elle avait transporté une bassine
d'eau bouillante et d'affreux gants de crin. Tu hurlas lorsqu'elle te toucha.
Je me suis exécuté. Je revins, rasé de frais, habillé comme déjà pour un
enterrement, vers dix heures moins le quart...
Madame Langlois sortit de la
chambre, rouge...
« La médecine ne peut plus
rien faire pour Madame. Je suis impuissante. Elle ne passera pas la journée.
C'est à vous, mon père, à vous, l'époux, monsieur de Saint-Aubain, qu'il
incombe de veiller à ses derniers instants. »
J'ai pensé à ta phrase, à ton
cri, lorsque, après ta confession immonde, tu t'étais refusée à moi, à ton « Non,
je ne veux pas! », à cette horrible « Hamadryade indienne » au
caractère choquant, fille de Gomorrhe pornographique! C'était il y a deux ans!
Mais je chassai ces mauvaises pensées.
Madame Langlois continua :
« J'ai pansé Madame de
Saint-Aubain comme j'ai pu ; j'ai désinfecté son dos ; j'ai renouvelé les
bandages... Mais ce dos, la pauvre petite! Ce dos n'est plus que purulence,
gangrène et plaies ouvertes et ses entrailles ne doivent guère valoir mieux. Ne
lui dites pas qu'elle va passer, ne le lui dites toujours pas! Elle est
parfaitement lucide! Elle ne doit pas savoir. La pauvre n'a même plus la force
d'aller au vase de nuit... »
L'infirmière dévouée, magnifique,
robuste, partit, croisant Norbert qui annonça :
« Mademoiselle Delphine Ibañez
y León!
- Introduisez-la,
Norbert... »
J'annonçai la nouvelle à l'aimée
moribonde qui esquissa un sourire entre deux halètements. Elle me désigna la
commode.
« Le
second...tiroir...murmura t-elle...les deux enveloppes avec les rapports des sœurs
infirmières sont là... Laisse-moi t'avouer enfin une chose... Je vais te révéler
de qui était le dernier enfant que je perdis en novembre... »
Elle me dit à l'oreille :
« Claude... Claude Debussy,
le musicien... Pardon, mon Albin, oui, pardon... »
Norbert introduisit Mademoiselle
Delphine et nous dûmes nous mettre en scène devant la fillette! Quel dérisoire
vaudeville mortifère nous lui jouâmes alors! Il était onze heures passé de
douze minutes en cette fin de matinée du 11 mars 1894. Le temps s'était adouci
et le printemps tentait d'esquisser son entrée.
Cette petite fille aux cheveux
d'un noir bleuté, au teint mat, aux yeux sombres, je la connaissais déjà pour
l'avoir vue à ce fameux concert de chambre où, sous la défroque de notre
malheureuse Lise, tu t'étais évanouie, mon amour...
Mais une angoisse m'étreignit,
furtive d'abord, puis de plus en plus précise : je sentis sourdre en moi une
inquiétude, telle l'ébullition d'une eau volcanique surgissant d'un solfatare
en un paysage désolé de l'Islande, cette île aux lépreux dépeinte avec un réalisme
non dépourvu de complaisance par Monsieur Jules Verne dans son fameux « Voyage
au centre de la terre ». Cette sensation était semblable à quelque précipité
chimique, comme la réaction d'un acide quelconque au contact de l'argile. Je
craignais que Deanna Shirley n'arrivât prématurément, qu'elle pénétrât subrepticement
dans cette chambre d'agonie sans qu'elle eût été annoncée par Norbert, qu'elle
surprît la choquante confession de l'aimée à la petite Delphine, au risque
d'engendrer en elle un diffus mais tenace sentiment de jalousie envers
celle qui, plus jeune, avait inconsidérément été l'ultime passion de ma
malheureuse mie. Ce sentiment, quel qu’infondé qu'il fût, passa heureusement,
et il n'en demeura qu'une écume de surface, promptement évaporée : la peur céda
la place à une relative félicité. Je délaissai ce qui me sembla, avec le recul,
une introspection malsaine, pour ne pas écrire malséante, pour me concentrer
sur notre comédie des adieux.
Delphine assisterait donc à ton
ultime confession, puisque tu l'avais voulu ainsi. Tu insistas pour accompagner
le prêtre en ses psalmodies, ses litanies aux agonisants, en rémission de
tes péchés, malgré tes empyèmes, tes amas de pus en ta cavité pleurale,
malgré les nécroses caséeuses qui t'étouffaient de plus en plus, te
congestionnaient. Tu étais trempée de sueur, mon pauvre chou d'amour! Après trépas,
on publierait à ton sujet, en l'honneur funèbre de la belle poëtesse, dans la
presse nationaliste, dans la Revue de Monsieur Brunetière, parangon de
la réaction, maints articles laudatifs que nos ladies – tes lectrices
assidues - commenteraient allègrement autour d'une tasse de thé agrémentée
de scones, en jouissant de leurs caquetages de poules emplumées ridicules.
Quelle fatuité!
Je me surpris à te gronder, à te
morigéner :
« Aurore-Marie, cessons donc
là cette comédie! Le temps des momeries est révolu! »
Je ne sus plus si je pensais aux
faux-semblants religieux tandis que tu balbutiais pitoyablement tes prières en
hoquetant, ou si je songeais à tes enfantillages, car, si tel était le sens perçu
par la petite Delphine, elle comprendrait mômeries avec le petit
chapeau... Le ton que j'employais à prononcer ces termes m'attrista, tellement
il était sentencieux et inapproprié à ces circonstances dramatiques. Ton teint
livide et cireux montrait l'imminence de la fin. Tu pus, on ne sait par quel
miracle, user tes dernières forces en tendant les enveloppes à celle que tu
nommais inconsidérément « ma tendre amie », quelles que choquantes
qu'apparussent ces paroles aux oreilles du ministre de Dieu... Après tout, elle
te prenait encore pour Lise. Je perçus, lorsqu'elle lut les comptes-rendus des
sœurs – mais fut-ce de ma part simple imagination ou pure intellection? -,
combien son esprit était choqué, combien elle fut interloquée.
Ce fut alors que Delphine prononça
ces mots :
« Lise tu fus pour moi, Lise
pour toujours tu resteras. »
Devant cet évident manque
d'acceptation de la réalité, je ne sus si je répétais encore stupidement le mot
momeries ou mômeries...
Tu as alors dégoisé cet
extraordinaire discours, cet aveu, cette péroraison, cette confession à
Delphine, sans respiration ni pause, lui demandant pardon...le rythme s'accélérait,
les mots s'entrechoquaient. Vite, vite finir...en finir car la Mort vient...
Plus vite, encore, encore, car cette fois, nulle échappatoire, et, pour
paraphraser ton poëme, le tombeau est bien là qui t'attend, jà ouvert, en ta hâte
d'en terminer à jamais. Ma fleur! Mon amour !
Des larmes perlèrent sur mes
joues, que j'essuyai discrètement afin d'éviter que tu ne les visses : je
refusais de te peiner. Après tes dernières phrases, qu'entendit mademoiselle
Delphine :
« Je...je...j'ai trente ans!
Pardon, Delphine de t'avoir trompée sur mon âge et mon identité et d'avoir éprouvé
pour toi une attirance coupable ! Pardon... », je crus capter - mais était-ce
une plainte, un gargouillement, un gémissement que nul d'autre que moi
n'entendit? - une supplique ultime : « Deanna ! Viens, Deanna ! »
Puis, il y eut l'ultime étouffement,
l'hématémèse finale... Mon Aurore adorée retomba sur l'oreiller, la bouche en
sang, ses grands yeux de résine grands ouverts... J'approchai une petite glace
de cette bouche... Nulle buée....mon pauvre ouistiti avait cessé de respirer.
La petite Delphine fondit en
larmes... Il était aux environs de midi, et le père Mathieu déclara :
« Elle est morte, son âme a
rejoint le Ciel où Notre Seigneur, en Sa miséricorde et Sa mansuétude,
l'accueille maintenant en Son giron. Prions pour elle! »
Il entama un Pater noster que
nous répétâmes tous, Delphine, les domestiques et moi... Ma pauvre femme
semblait transfigurée...apaisée... Nul rictus de mort en elle, mais, au
contraire, une expression christique... Je devais la faire apprêter, habiller
d'une robe noire. Aurore-Marie n'était pas décédée intestat. Elle avait rédigé
ses dernières volontés à l'été 1892, après cette fameuse crise lors de
l'affaire Hubeau-Ballanès.
La dépouille de l'aimée fut
arrangée, lavée, et nous la revêtîmes d'une robe de satin et de bengaline aux
manchettes de chinchilla, d'un noir moiré. Au cou de cygne de l'adorée, le camée
de calcédoine et de corindon au profil de Déméter. Aurore-Marie tenait
particulièrement à ce bijou, cadeau du romancier et poëte Gabriele d'Annunzio,
qu'elle avait surnommé « mon disciple favori », offert à Venise à l'été
1888, enchâssé à l'origine dans un coffret de laque, d'émail et de corail. Sa
plantureuse chevelure blonde avait été assemblée et attachée en un lourd
chignon. Le corps reposait, comme sur un lit de parade...dans notre chambre
originelle de la propriété, avant qu'elle ne fît chambre à part partout où nous
logions...
Vers treize heures vingt-cinq, la toilette
mortuaire était terminée... Il me fallait prendre mes dispositions pour les funérailles
et je craignais que Maubert m'ordonnât une autopsie, après que Madame Langlois
eut constaté le décès. Je demandai qu'on préservât le corps de l'adorée.
(...)